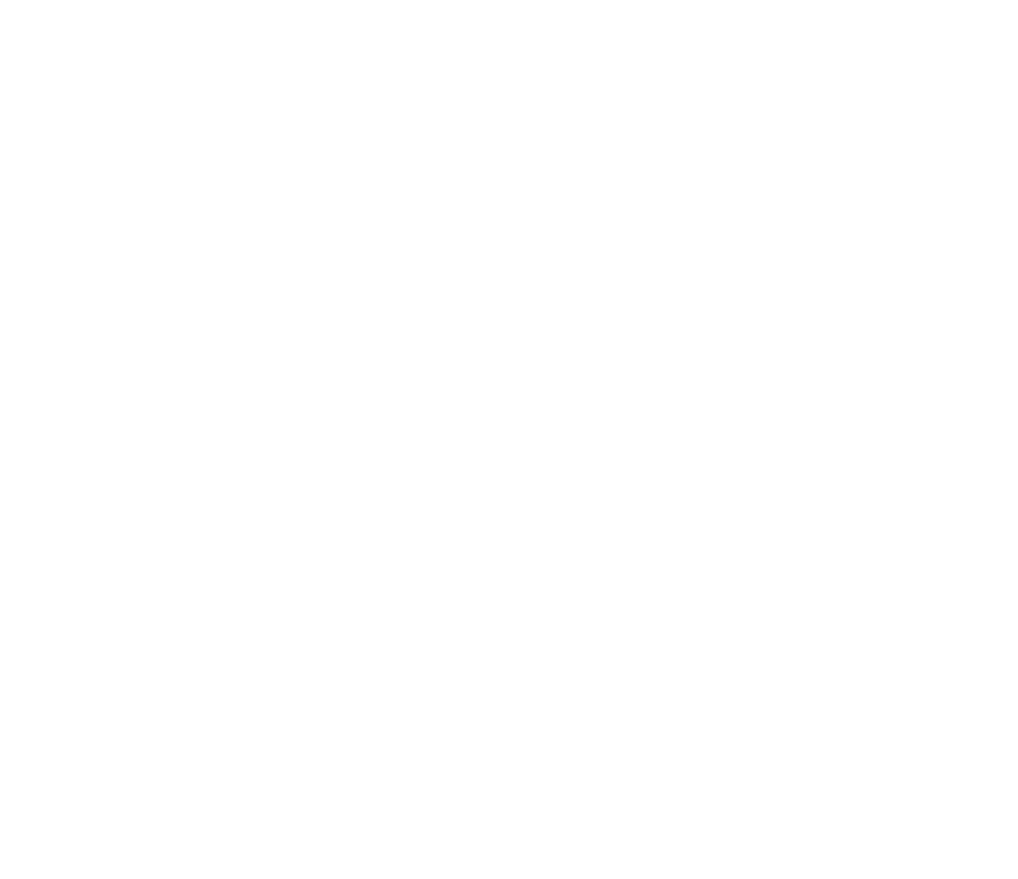Beaucoup de personnes se posent la question : comment les magnifiques cénotes que l’on connaît aujourd’hui ont-ils été formés ?
La vérité, c’est que d’épaisses couches de calcaire, issues d’organismes marins, se sont accumulées au fil du temps, formant une vaste plateforme. Lorsque le niveau de la mer a baissé, cette plateforme a été exposée.
Ce sol calcaire, très poreux, a ensuite été lentement creusé par l’eau de pluie, légèrement acide, donnant naissance à un immense réseau de grottes souterraines.
Avec le temps, certains plafonds de ces cavernes se sont effondrés, révélant les cénotes tels que nous les connaissons aujourd’hui.
Ce phénomène naturel, connu sous le nom de karstification, s’est déroulé sur plusieurs millions d’années, sculptant peu à peu l’un des paysages les plus fascinants du Yucatán.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, leur formation ne s’est pas faite en quelques années, mais bien à travers un lent et patient processus géologique étalé sur des millions d’années.
C’est quoi un cénote ?


Les cénotes sont des puits naturels, aussi appelés dolines, caractéristiques des régions calcaires, en particulier dans la péninsule du Yucatán au Mexique. Leur formation résulte d’un long processus géologique qui s’étend sur des millions d’années et comprend plusieurs étapes clés.
Le rôle des couches de calcaire dans la formation des cénotes
C’est principalement grâce à l’abondance de calcaire que l’on retrouve autant de cénotes dans la péninsule du Yucatán.
Lorsque le niveau de la mer a baissé, il a exposé la roche calcaire à l’air libre, la rendant plus vulnérable à l’érosion provoquée par l’eau de pluie.

Mais Cyril, c’est quoi le calcaire ?
Le calcaire est une roche sédimentaire, principalement composée de carbonate de calcium (CaCO₃), et parfois aussi de carbonate de magnésium (MgCO₃).
On le reconnaît facilement à sa teinte blanche et souvent à la présence de fossiles.
Il se forme le plus souvent par l’accumulation de débris de coquillages, de squelettes d’organismes marins, ou encore par précipitation chimique dans les milieux aquatiques. C’est une roche qui se dissout au contact de l’eau légèrement acide.
Au fil de milliers d’années, cette interaction entre l’eau et la roche a permis la formation d’immenses réseaux de grottes et de dolines.
Pourquoi l’eau des cénotes est-elle aussi claire ?
Ce qui rend la plongée en cénote particulièrement attrayante, c’est la clarté de son eau !
L’eau des cénotes est aussi limpide parce que le calcaire agit comme un filtre naturel, retenant les impuretés. Résultat : une eau d’une transparence exceptionnelle, idéale pour la plongée !

La pureté de l’eau des cénotes permet une visibilité pouvant atteindre jusqu’à 30 mètres, offrant ainsi aux plongeurs une vue parfaitement dégagée sur les formations rocheuses et les jeux de lumière sous-marins.
Pour certains plongeurs, comprendre comment les cénotes se sont formés permet de réaliser que plonger dans un cénote, ce n’est pas simplement nager dans un bassin d’eau ou explorer une grotte. C’est s’immerger dans un lieu chargé d’histoire géologique, façonné par la nature pendant des millions d’années.
L’impact de l’eau dans la formation des cénotes
L’eau de pluie, légèrement acide en raison du dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère, s’infiltrait peu à peu dans les fissures de la roche calcaire.

Au fil du temps, cette interaction a lentement dissous la roche, formant un vaste réseau de grottes et de rivières souterraines.
Ce phénomène est connu sous le nom de karstification.
L’effondrement des plafonds et la naissance des cénotes
Lorsque le plafond de ces grottes devenait trop mince pour supporter son propre poids, certaines cavités se sont effondrées, ouvrant ainsi un accès direct à la nappe phréatique ou aux rivières souterraines. C’est ainsi qu’est né le cénote.
Selon l’ampleur de l’effondrement, différents types de cénotes se sont formés : les cénotes ouverts, semi-ouverts et fermés.
Les différents types de cénotes
Les cénotes, ces puits naturels d’eau douce emblématiques de la péninsule du Yucatán, se distinguent principalement par leur forme, leur exposition à la lumière et leur stade d’évolution géologique. On en distingue généralement quatre grands types :
Cénote ouvert
Ce type de cénote est totalement exposé à la surface, souvent de forme circulaire ou ovale, et ressemble à un étang naturel.

L’accès à la lumière y est maximal, ce qui favorise le développement de la végétation et de la vie aquatique.
Parmi les cénotes ouverts les plus populaires, on retrouve le Cenote Azul et le Cenote Jardín del Edén.
Cénote semi-ouvert
Ce type de cénote possède une ouverture partielle vers l’extérieur, laissant entrer la lumière du soleil tout en conservant une partie de sa voûte rocheuse.


L’accès se fait souvent par une petite ouverture, et la lumière y crée des jeux d’ombres spectaculaires sur l’eau.
Parmi les cénotes semi-ouverts, on retrouve le cénote Dos Ojos et Chac Mool, deux sites réputés et particulièrement appréciés pour la plongée sous-marine en cénote.
Cénote fermé
Entièrement souterrain, ce cénote se présente comme une grotte dont l’entrée est souvent étroite.

Très peu de lumière y pénètre, ce qui crée une atmosphère mystérieuse, avec des eaux turquoise ou vert émeraude, souvent ornées de stalactites et de stalagmites.
Parmi les cénotes fermés, on retrouve le célèbre cénote Taak Bi Ha.
Chaque type de cénote offre une expérience unique, que ce soit pour la baignade, la plongée ou l’exploration de la géologie et de la biodiversité locale.
Que peut-on voir dans les cénotes ?
Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il est possible d’observer une multitude de choses dans les cénotes.
Ces puits naturels offrent un spectacle fascinant, mêlant nature, vie sauvage et histoire. Leur eau cristalline permet d’admirer les reliefs sous-marins avec une clarté exceptionnelle.


Dans les grottes ou les cénotes semi-ouverts, les visiteurs peuvent admirer de superbes formations de stalactites et de stalagmites.
La biodiversité y est également remarquable. On y trouve une multitude de poissons, des tortues, et même des micro-organismes uniques au monde.
Au-delà de l’aspect naturel, ce qui est selon moi le plus impressionnant dans un cénote, c’est son atmosphère, sublimée par les jeux de lumière filtrant à travers les ouvertures. La lumière illumine l’eau et les parois dans un spectacle presque irréel.
Certains de ces lieux, chargés d’histoire, ont même révélé des vestiges archéologiques majeurs, rappelant leur rôle sacré dans la civilisation maya.